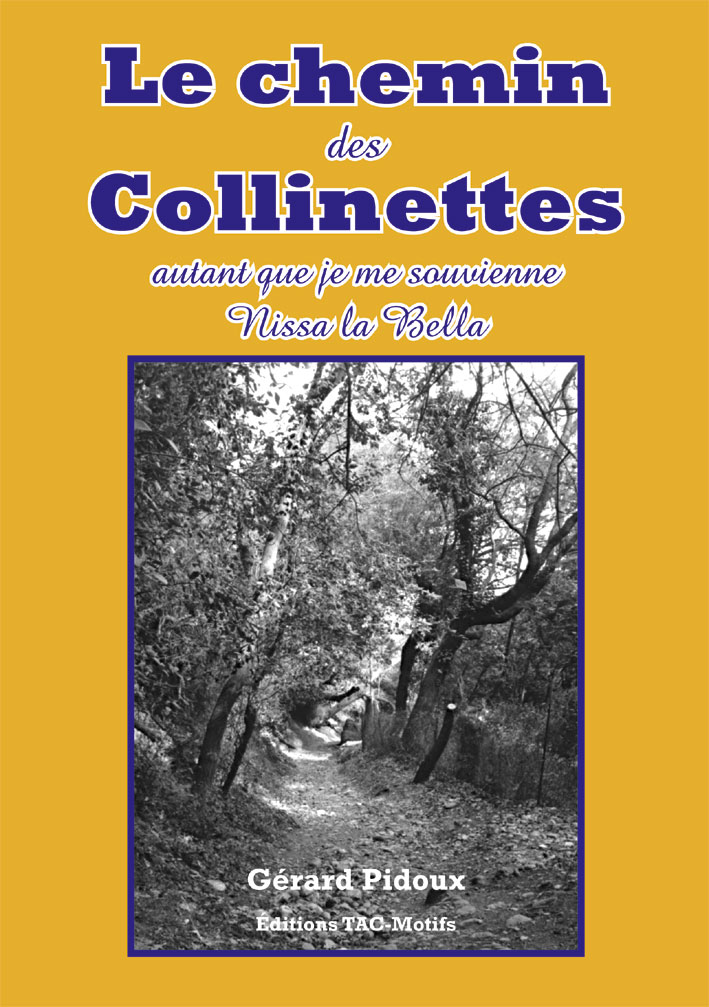
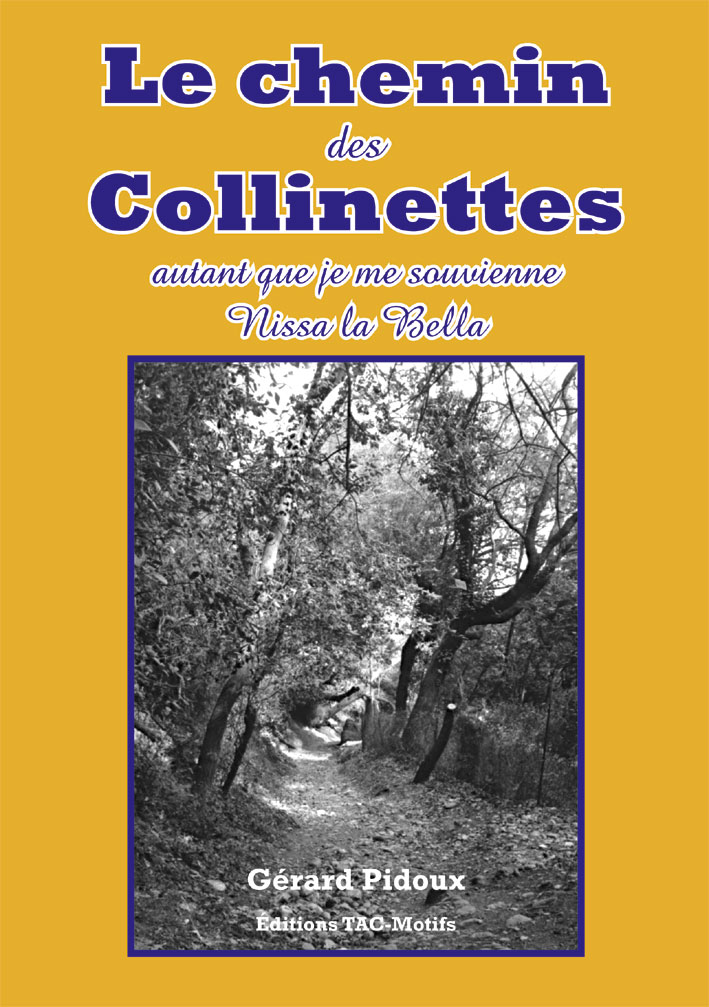
Le chemin des collinettes
L'emménagement
Huit heures du matin à Nice, il faisait encore bon. Mon père
gara la 203 presque au coin de la rue Saint-Philippe, au prix d'une savante
manœuvre, certes, mais cela nous avait permis de nous trouver à
deux pas de notre nouveau domaine. Parvenus devant le magasin, papa chercha
tout d'abord les clés dans la poche droite de son pantalon, passa rapidement
à la poche gauche, puis les réclama à ma mère.
Devant ses dénégations, il poussa un gros soupir, fouilla sa
veste, pesta, pour trouver enfin le trousseau lors d'une ultime exploration…de
la poche droite de son pantalon.
Nous nous étions bien gardés de faire le moindre commentaire,
nous évitant, par-là même, une orageuse justification.
Il ouvrit successivement les deux serrures de la double porte de bois, puis
celle de l'entrée. Une curieuse odeur de tissu neuf pénétra
nos narines : Nous étions chez nous, au numéro soixante-huit
de la rue de France, à Nissa la Bella comme disent les gens d'ici.
La matinée était douce, parfumée de l'air de la mer.
Nous n'étions qu'à quelques pas de la Promenade des Anglais.
Il était encore un peu tôt pour que la circulation, habituellement
étouffante dans la journée, envahisse la rue. Un tramway matinal
fit tinter sa cloche guillerette au croisement du boulevard Gambetta et s'éloigna
dans un bruit de ferraille bien sympathique. Le conducteur, le wattman comme
on l'appelait alors, appuyé sur le fond de sa cabine semblait sommeiller,
tandis que son unique passager, le receveur, ne laissait entrevoir que le
haut de sa casquette au travers de glaces impeccablement transparentes.
La proximité de l'heure de pointe était sans nul doute la cause
de ce recueillement intense avant de subir l'assaut imminent de toute une
population laborieuse, impatiente de se rendre sur les lieux de son travail.
Mon père nous fit découvrir notre nouvelle demeure. Elle se
composait de deux grandes pièces dont l'une servait de cuisine et de
salle à manger. L'autre faisait office de chambre et de salle de toilette.
Il fut décidé que mon divan prendrait place dans la première,
tandis que mes parents occuperaient la seconde.
Notre installation dura jusqu'au soir. Et pour cause : Le camion, qui devait
nous amener les quelques meubles possibles à caser dans notre petit
logis, s'était perdu et ne trouva plus à se garer lorsqu'il
arriva vers onze heures trente. Après bien des palabres, et d'un commun
accord, on cassa la croûte avant l'effort : L'heure sacro-sainte du
pastis, suivie de celle du repas, non moins importante, allait certainement
libérer des places. Ce qui se réalisa au-delà de tous
nos espoirs.
L'intendance, bien entendu assurée par ma mère, se montra digne
de tous les éloges. Si bien que gavés de poulet, petit salé
et autres charcuteries diverses, les déménageurs, anesthésiés
au vin du Var, eurent bien du mal à commencer de vider leur camion.
Beaucoup plus que lors de l'opération identique effectuée précédemment
à l'encontre des bouteilles, si l'on en jugeait par le nombre respectable
de flacons abandonnés sur les tomettes de la cuisine.
Impressionnée et prise de court par la consommation pléthorique
du précieux liquide, bien qu'elle en ait vu d'autres, ma mère
était judicieusement repartie dans l'après-midi, dare-dare,
au ravitaillement.
Ceci eut pour heureux effet de galvaniser l'ardeur au travail de ces braves
gens. Si bien que le soir vers neuf heures, tout était consommé,
bouteilles comprises, ou presque... Ils repartirent d'une démarche
étonnamment assurée, qu'une élocution sérieusement
altérée n'aurait cependant pas laissé prévoir.
Ma mère réunit alors les restes du repas et sortit un flacon
rescapé d'on ne sait où. Nous nous retrouvions, tous les trois,
à la lueur d'une seule ampoule, à commenter la journée,
élaborant le programme du lendemain, entourés de caisses et
de colis. Mais nous étions bien. Il ne nous manquait plus que Taïau,
notre gros chien, mis, provisoirement, "en pension" chez ma cousine
Roberte et Jean, son mari, que je continuais à appeler Coudin Dan en
souvenir de ma toute petite enfance. Ils habitaient la rue Léotardi,
près de la place Arson, temple des joueurs de boule.
Malgré ma fatigue, je dormis d'un sommeil agité. Seul le petit
jour parvint à calmer mon excitation.
Lorsque je m'éveillai, la physionomie de la pièce dans laquelle
on avait installé mon lit avait bien changée ! Plus de cartons.
Sur le sol, seules les tomettes rouges brillaient et maman rangeait sa vaisselle
dans le buffet. Bon nombre de bruits confus et diverses interjections m'indiquèrent
que mon père, à côté, était en train de
monter quelque meuble.